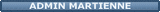Chez Terry Gilliam, un seul mot d'ordre : l'imagination. La plus débridée possible.
Néanmoins, il convient d'être honnête et d'avouer que maître Gilliam a un défaut : un tempérament débordant, un goût du challenge pour le challenge qui l'amène souvent à se lancer dans des entreprises hasardeuses, pour ne pas dire franchement bancales. Une difficulté à contenir ses pulsions créatrices qui partent parfois un peu dans tous les sens. Quand le réalisateur parvient à maîtriser ce cheval fou, cela peut donner un chef-d’œuvre absolu (Brazil) ou de très bons films (Bandits bandits, L'armée des 12 singes). Quand il n'y parvient pas, cela peut donner Las Vegas Parano ou, dans une moindre mesure, Les frères Grimm.
Qu'importe. Terry Gilliam demeure l'un des réalisateurs - l'un des créateurs d'univers - les plus follement originaux et excitants du cinéma contemporain. Petit résumé d'une (tumultueuse) carrière, en attendant la suite :
Je ne vais pas me lancer dans un biographie complète mais il n'est pas superflu de remonter un peu à la source. Comme chacun sait (ou devrait le savoir), Terry Gilliam fut l'un des joyeux allumés de la bande des Monty Python. Il n'était pas le plus drôle, ni le meilleur des acteurs mais Gilliam avait par contre un atout solide par rapport à ses condisciples : un talent pour les graphismes délirants, les trucages et (déjà) la réalisation. C'est à lui que nous devons entre autres ces petits intermèdes animés que l'on trouve dans les films des Python, ainsi que le cultissime Sacré Graal (1975) qu'il co-réalise avec Terry Jones.
Le groupe s'étant séparé, Gilliam réalise alors en solo son premier long-métrage : Jaberwoccky (1977). C'est une farce bien déjanté se situant dans un Moyen-âge crasseux et paillard, loin des clichés romantiques véhiculés par certains films hollywoodiens. Prometteur, ce film n'est encore qu'un galop d'essai pour un réalisateur encore sous l'influence pythonienne.
Son second, Bandits bandits (1981), se situe entre le conte et la SF et jongle allègrement avec les époques grâce à un pitch très simple comme prétexte : une bande de nains voleurs capables de voyager dans le temps grâce à une carte qui leur indique l'emplacement des passages. Par erreur, ils se retrouvent dans la chambre d'un enfant de l'Angleterre contemporaine qu'ils emmènent dans leurs pérégrinations temporelles. Nous côtoyons ainsi un Napoléon obsédé par sa petite taille, puis un Robin des Bois plus stupide que sa légende (John Cleese). Prochaine étape : l'Antiquité et la rencontre avec un roi de légende (Sean Connery). Mais pendant que notre bande de coquins cherche la fortune à travers le temps, un maléfique personnage (le Diable ?), aux pouvoirs surnaturelles, cherche à récupérer la carte.
En fait, vouloir résumer ce film est une gageure, tant les péripéties sont nombreuses et ne peut de toute façon pas rendre compte du délire visuel permanent qui y règne et des scènes grandioses, alors que le budget du film est dérisoire. En effet, à le voir, le film semble avoir coûté dix fois plus et ce grâce à l'ingéniosité de son réalisateur et au fameux système D.
Bandits, bandits est pour moi le premier film qui porte véritablement la marque de Gilliam. On y retrouve déjà le foisonnement visuel de ses films suivants, l'humour, le goût pour les êtres marginaux, les thèmes (la quête, l'enfance, le voyage dans le temps et l'espace), la fantaisie furieuse. Tout Gilliam est déjà là.
Brazil n'est plus vraiment à présenter. Chef-d’œuvre du réalisateur sorti en 1984, il représente une sorte de manifeste pour tout amateur du cinéma de Gilliam en particulier et de la SF en général. Moins bordélique et plus sombre que Bandits, bandits, Brazil est un film parfaitement maîtrisé de bout en bout. Sur la forme, c'est un feu d'artifice d'inventions, un bouillonnement artistique rarement égalé qui laisse le spectateur pantois après la première vision (et même les suivantes). Sur le fond, le film s'inspire du 1984 d'Orwell et son univers totalitaire en nous plongeant dans une sombre histoire de fonctionnaire (Jonathan Pryce), instrument d'abord servile du pouvoir dictatorial qui ne trouve qu'un échappatoire provisoire dans ses rêves et finit par se rebeller contre le système.
C'est le grand classique de Gilliam, celui auquel désormais tous ses autres films auront la (difficile) tâche de lui succéder. Et force est de reconnaître que, depuis, le réalisateur n'a jamais retrouvé une telle inspiration.
Son suivant, Les aventures du Baron de Münchausen (1988), est une entreprise pharaonique dans laquelle Gilliam, sans doute galvanisé par le succès de Brazil, a bien failli se casser les dents. C'est la première fois que le réalisateur se retrouve victime de son tempérament et d'une certaine dose de mégalomanie. Financièrement, le film est un gouffre, les dépassements budgétaires que demandent une telle entreprise risquant de condamner le film. Finalement, Gilliam mène son navire à bon port mais il en ressort lessivé. Pour ne rien arranger, l'accueil du public est plutôt tiède. Cette "fantaisie stratosphérique" qui raconte les aventures du célèbre Baron au XVIIIiè siècle est certes un régal pour les yeux mais on frise parfois l'indigestion. Reste malgré tout un film hors-normes, monstrueux, et comme toujours avec Gilliam, les morceaux de bravoure côté réalisation se succèdent sans temps morts.
Après la leçon tirée de son précédent film, Terry Gilliam revient en 1991 avec un film beaucoup plus modeste, du moins sur le plan budgétaire. Il a aussi l'intention de montrer patte blanche aux grands studios auprès desquels il s'était fait la réputation d'un réalisateur gaspilleur et ingérable. Avec Fischer King, Gilliam délaisse pour la première fois les environnements trop complexes (et trop coûteux) pour situer son histoire à...New-York. Mais, bien évidemment, Gilliam ne peut se contenter de filmer la Grosse Pomme de manière banale. Aussi, c'est un New-York décalé qu'il nous propose, baroque, avec château-fort au milieu des gratte-ciels, clochard en quête du Saint-Graal et terrifiante vision d'un chevalier au destrier galopant dans les rues de Manhattan en crachant le feu.
En dehors de ces scènes oniriques, Fischer King raconte l'histoire de deux hommes, que tout oppose au départ : Jack (Jeff Bridges), animateur radio cynique et fortuné, qui se ballade dans un New-york huppé et branché sur fond de "I've got the power". Le second, Henry (Robin Williams) est un clodo au cerveau dérangé qui se prend pour un chevalier de la table ronde en pleine quête du Graal. Hors, à la suite d'une terrible tragédie qui amène le cynique Jack à tomber au plus bas, les deux hommes se rencontrent, sympathisent et finiront par retrouver la paix de l'esprit.
Au-delà de l'inventivité visuel, Gilliam, fidèle à la morale qu'on retrouve dans tous ses films, montre à nouveau le rôle bénéfique que peut avoir l'imaginaire face au désespoir mais aussi la nécessité de sortir de ce rêve pour affronter ses propres démons. On remarquera d'ailleurs qu'il s'agit du seul véritable happy end dans la filmographie de Gilliam, ce qui montre bien l'influence des studios et la décision du réalisateur de faire quelques compromis.Si le film est moins réussi que Brazil, il porte malgré tout la patte d'un Gilliam qui se sort avec les honneurs dans le registre, moins habituel pour lui, de la comédie dramatique.
L'armée des 12 singes (1995) voit le retour d'un Terry Gilliam en grande forme. Ayant apparemment retrouvé la confiance des studios, il a l'occasion d'avoir une star en tête d'affiche (Bruce Willis) et des moyens relativement importants. Le scénario du film s'inspire du court-métrage français La jetée de Chris Marker (1963), œuvre expérimental qui bénéficie d'une belle notoriété auprès des amateurs de SF (mais pas seulement).
Gilliam n'en garde en fait que le thème central : dans un futur proche où ce qui reste de l'humanité, après avoir été décimée par un virus, habite sous terre, une expérience de voyage dans le temps est mise au point. Son but : retourner dans le passé avant la contamination afin de trouver les responsables de la catastrophe et le virus pour pouvoir en faire un antidote. Le candidat est James Cole (Bruce Willis), choisi pour ses grandes capacités mentales et physiques. Mais le (ou plutôt les) voyages successifs de Cole à la recherche du virus mettent à rude épreuve cet homme tiraillé entre son devoir et l'envie de rester dans ce merveilleux 20iè siècle où l'air est si pur (sic !).
Ici encore, impossible de résumer en quelques phrases un film qui, s'il se révèle pourtant plus sobre que Münchausen ou Brazil, n'en demeure pas moins d'une grande richesse.
A noter que ce film connaîtra un beau succès public, chose qui n'était plus arrivée à Gilliam depuis longtemps.
Avec Las Vegas Parano (1998), Gilliam, qui sent à nouveau son goût pour les challenges le titiller, se lance dans un projet pour le moins hasardeux en s'efforcant d'adapter l'inadaptable, c'est à dire la prose d'Hunter Thompson et son livre du même nom. De l'histoire, qu'en dire au juste : il n'y en a pas ! Tout au plus pouvons-nous parler de l'escapade sous acide d'un journaliste excentrique (joué par un Johnny Depp aux expressions cartoonesques) et de son pote tout aussi azimuté. Le film est en fait une succession d'images bizarres censées représenter les visions des deux personnages en trip perpétuel. Quand au fil conducteur (très ténu), on l'oublie bien vite, de même que les personnages qui ne savent plus très bien, au même titre que le spectateur, ce qui ressort au juste de toute cette béchamel. Vous l'aurez compris : je n'aime guère ce film qui illustre parfaitement les débordements d'un Gilliam qui se laisse aller à un délire qui tourne à vide. A moins peut-être de voir le film sous acide.
Le prochain projet de Gilliam lui tenait particulièrement à cœur. C'est donc la mort dans l'âme et découragé qu'il dut finalement abandonner le tournage de L'homme qui tua Don Quichotte au bout de quelques jours, la malchance semblant s'être spécialement acharnée sur ce film prometteur. Conditions météorologiques désastreuses, acteur principal (Jean Rochefort) souffrant de maux de dos persistants mettront un terme à l'aventure. Reste un documentaire, Lost in La Mancha (2003) qui témoigne du fiasco tout en donnant une petite idée de ce que le film aurait pu être.
Dépité, Terry Gilliam mettra un certain temps à remonter dans l'arène. Quelques projets avortés plus tard, sortira finalement, en 2005, Les frères Grimm. Le film montre que Gilliam n'a rien perdu de sa verve visuel et de son goût pour les contes et les créatures fantastiques. Pourtant, le film m'a laissé sur ma faim. J'en espérait mieux. Impressionnant sur le plan formel, bénéficiant de gros moyens, Les frères Grimm ne suscite pas l'émotion qui viendrait transcender ce spectacle somptueux mais sans âme.
Après la grosse machinerie des frères Grimm, Gilliam sort peu de temps après un film à petit budget, Tideland (2006). De tous ses films, Tideland est sans conteste le plus glauque, celui qui génère un sentiment de malaise du début à la fin. On pourrait appeler ce film "Alice aux pays des horreurs". Gilliam reprend certes son thème de prédilection - l'imaginaire (ici enfantin) comme échappatoire à un réel peu reluisant. Certes, Brazil était sombre mais son humour et son inventivité rendait le tout plus respirable. Dans Tideland, par contre, le spectateur se sent pris à la gorge jusqu'à la nausée et l'absence d'humour n'arrange rien : une petite fille qui prépare les seringues de son père toxico, ce même père qui meurt d'une overdose sur sa chaise et qui se met à pourrir sur place entouré par les mouches jusqu'à ce qu'une voisine givrée le taxidermise, voilà qui n'est guère ragoûtant. Pendant ce temps, la fillette, fidèle au modèle gillamien, préfère s'inventer un monde magique fait d'amis imaginaires et de lucioles. Tout cela pourrait passer si le film parvenait à éveiller l'intérêt mais je dois dire que, pour ma part, je suis resté en dehors, presque impatient que le film finisse.
On devrait bientôt assister au retour Terry Gilliam avec The imaginarim of Dr. Parnassus, un projet déjà annoncé comme démesuré. Après trois films franchement moyens et un avorté, on ne peut qu'espérer que ce film se place parmi les meilleurs crus d'une filmographie brillante mais en dents de scie. Dans le cas contraire, il faudrait peut-être commencer à s'inquiéter.
Mais restons confiants